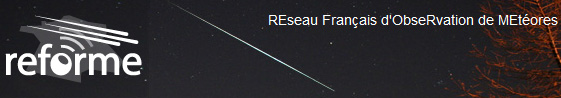Météorite d'Orgueil (Orgueil - Tarn-et-Garonne):
(Extrait wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Orgueil_(Tarn-et-Garonne) )
Cette météorite qui traversa le ciel français le 14 mai 1864 et vint s’écraser dans un champ de la commune d’Orgueil est une météorite d’une espèce très rare, seulement sept de cette nature sont connues dans le monde, celle d’Orgueil étant la plus grosse. Elle contenait un gaz rare, le XENON-HL.
Cette météorite a aidé tous les savants du monde à étudier ce que pouvait être l'univers avant la naissance de la Terre. La météorite contenait des poussières de diamants.
Des fragments de cette météorite ont été envoyés dans le monde entier pour servir aux études scientifiques, le Musée national d’Histoire naturelle conserve un morceau de 11 kg dans sa collection. En parcourant les pages sur la collection de météorite du Muséum d'Histoire naturelle de Paris vous apprendrez que Orgueil est très utilisée par les scientifiques et qu'elle a été utilisée pour déterminer la composition du soleil.
Le communiqué du CNRS du 10/09/2010
(Extrait wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Orgueil_(Tarn-et-Garonne) )
Cette météorite qui traversa le ciel français le 14 mai 1864 et vint s’écraser dans un champ de la commune d’Orgueil est une météorite d’une espèce très rare, seulement sept de cette nature sont connues dans le monde, celle d’Orgueil étant la plus grosse. Elle contenait un gaz rare, le XENON-HL.
Cette météorite a aidé tous les savants du monde à étudier ce que pouvait être l'univers avant la naissance de la Terre. La météorite contenait des poussières de diamants.
Des fragments de cette météorite ont été envoyés dans le monde entier pour servir aux études scientifiques, le Musée national d’Histoire naturelle conserve un morceau de 11 kg dans sa collection. En parcourant les pages sur la collection de météorite du Muséum d'Histoire naturelle de Paris vous apprendrez que Orgueil est très utilisée par les scientifiques et qu'elle a été utilisée pour déterminer la composition du soleil.
Le communiqué du CNRS du 10/09/2010
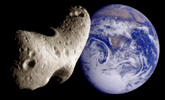
 Accueil
Accueil